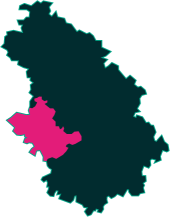Du château au Parc aux Daims
Balade dans le bourg médiéval
À partir de 1160, Châteauvillain prend forme autour de la famille Des Broyes et de leur château. Aujourd’hui détruit, il s’étendait sur tout le centre historique de l’actuelle cité. Dans la Tour de l’Auditoire, la seule qui subsiste encore de la basse-cour du château, une maquette vous permet d’imaginer à quoi ressemblait la cité médiévale avant la Révolution.
Au XIVème siècle, l’une des entrées de la ville se trouvait plein est. Cette porte dite “porte Madame” ouvre aujourd’hui sur le Parc aux Daims, 272 ha de forêt façonnés au fil des années par 200 daims qui vivent à l’intérieur de l’enceinte. Offrez-vous une belle balade en famille !


Le tour du chemin de ronde
Édifiées au XIIème et au XIVème siècle, deux enceintes fortifiées défendaient la ville. Flânez parmi ces murs de pierres sèches, le long d’un chemin de ronde percé autrefois de poternes, de ponts levis et de tours. La plus ancienne, la tour Saint-Marc dresse toujours ses murs épais de 2 mètres.

Le patrimoine d’une Petite Cité de Caractère®
À l’intérieur du bourg, le patrimoine bâti témoigne de l’importance de la ville. La Maison de la Prévôté, avec ses gargouilles, est la plus ancienne de Châteauvillain. Descendez un escalier caché pour accéder au lavoir tout proche. Son parquet flottant et sa belle charpente de châtaignier sont uniques.
À l’église Notre-Dame, une des plus belles de Haute-Marne, vous serez surpris par l’intérieur entièrement peint. Restaurée en 1780 par Soufflot, l’architecte du Panthéon, elle compte parmi les étapes de la via Francigena.

Découvrez Châteauvillain avec un guide
Plusieurs circuits permettent de visiter la ville. En saison, rendez-vous dans la cour de L’Auditoire pour une visite commentée (sur réservation à l’office de tourisme). Pour les enfants, des itinéraires ludiques sont à télécharger depuis l’application gratuite IDVizit.